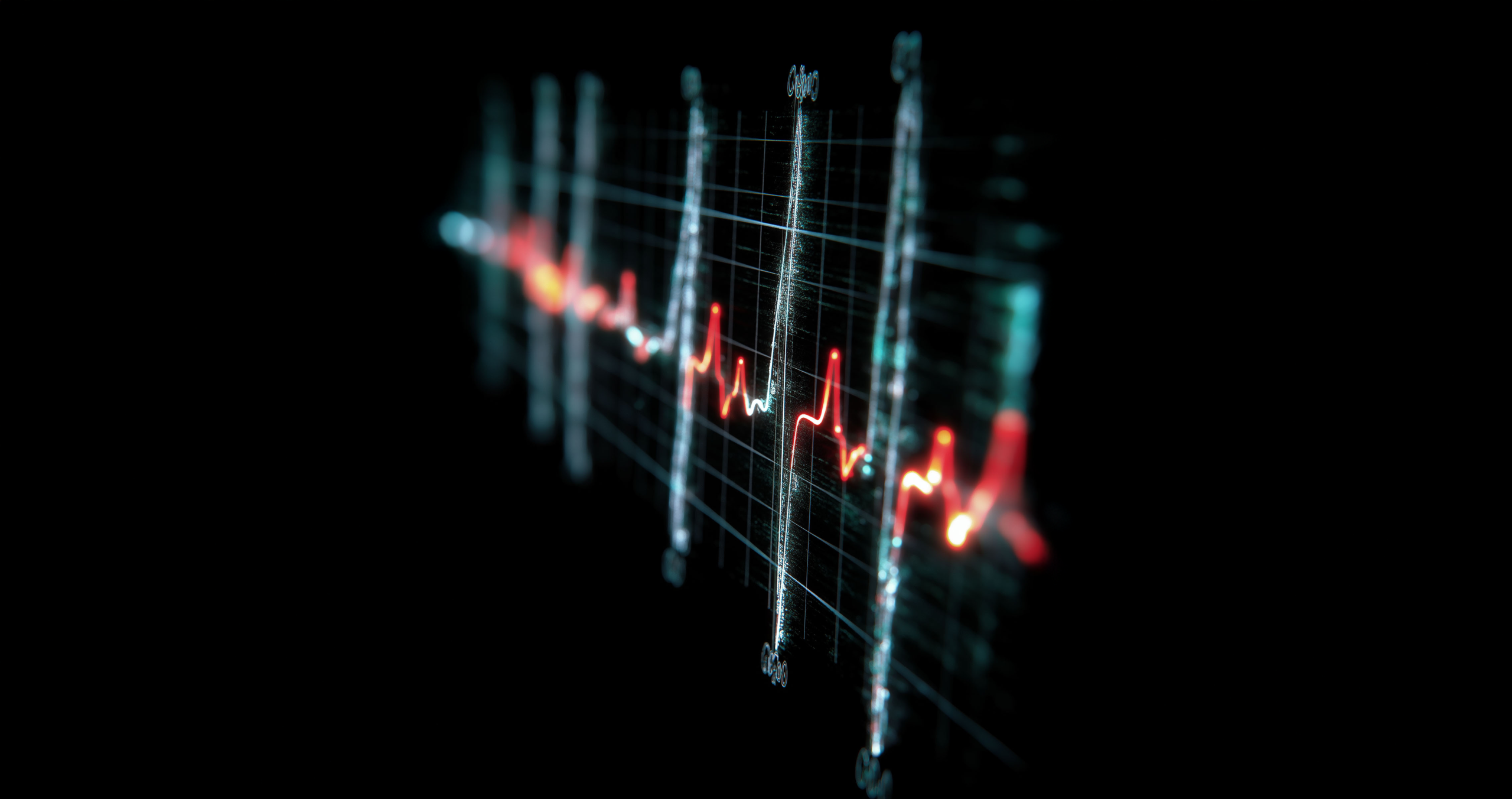
Maladie rénale chronique et hyperkaliémie
L’hyperkaliémie est fréquente dans la maladie rénale chronique (MRC), du fait de l’insuffisance rénale, mais aussi des traitement néphroprotecteurs et cardioprotecteurs indispensables. D’autres facteurs favorisent la survenue d’une hyperkaliémie, comme le diabète, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou encore une alimentation trop riche en potassium, autant de facteurs modifiables. La prise en charge médicale de l’hyperkaliémie, quant à elle, se fait en trois étapes : débuter ou augmenter le traitement par furosémide en cas de surcharge hydrosodée, puis apporter du bicarbonate de sodium si le patient reste en acidose et, enfin, si l’hyperkaliémie persiste, recourir aux chélateurs de potassium.
MRC : des traitements néphroprotecteurs et cardioprotecteurs indispensables… mais hyperkaliémiants !
Lorsque la fonction d’épuration du rein diminue, au fur et à mesure qu’une insuffisance rénale apparaît, la capacité d’élimination de certains déchets comme le potassium s’amenuise. Néanmoins, le rein garde assez longtemps cette capacité d’éliminer le potassium, jusqu’à un DFGe d’environ 20 à 30 ml/min/1,73m2. Si l’hyperkaliémie est généralement plus précoce dans la MRC, c’est que s’ajoute à cette dégradation de la fonction rénale la prescription de traitements néphroprotecteurs et cardioprotecteurs qui bloquent le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) : d’abord en monothérapie avec un IEC ou un ARA2, puis souvent en association avec un agent anti-aldostérone en cas de néphropathie diabétique ou d’insuffisance cardiaque. Le blocage du SRAA empêche l’élimination urinaire du potassium (et des ions H+) avec, pour conséquence, une hyperkaliémie (et une acidose), qui reste très longtemps asymptomatique.
L’hyperkaliémie va, en effet, avoir essentiellement un retentissement cardiaque (ralentissement de la conduction cardiaque), qui se manifeste cliniquement par une bradycardie, parfois associée à un essoufflement, une fatigue, une diminution de la pression artérielle et pouvant aller jusqu’à l’arrêt cardiaque. Il faut souligner que cet arrêt cardiaque est une asystolie, avec ECG complètement plat, non choquable, le patient ne pourra donc pas être ranimé par un défibrillateur.
Les conséquences cliniques de l’hyperkaliémie peuvent donc être dramatiques et doivent être prévenues.
Facteurs surajoutés déclenchant ou aggravant l’hyperkaliémie
Un patient présentant une MRC traitée par des agents bloqueurs du SRAA sera encore plus à risque d’hyperkaliémie s’il est diabétique car le diabète expose lui-même à un risque d’hyperkaliémie pour des raisons hormonales intrinsèques à la maladie (hypo-réninisme et hypo-aldostéronisme) et à cause de l’insulinopénie qui diminue l’entrée du potassium dans les cellules.
Les AINS, très largement consommés, notamment chez les sujets âgés, et souvent en automédication, augmentent le risque d’hyperkaliémie par un effet anti-rénine. Leur prescription est strictement contre-indiquée en cas d’insuffisance rénale traitée par bloqueurs du SRAA. Dans de telles situations, même pour des traitements courts, il est parfois préférable de prescrire une corticothérapie plutôt que des AINS. Quoi qu’il en soit, les AINS sont à proscrire en cas d’hyperkaliémie documentée.
Des écarts de régime alimentaire peuvent également être pourvoyeurs d’hyperkaliémie. Tout l’art de la « rééquilibration alimentaire » à recommander est de ne pas être trop restrictif et de bien détailler ses conseils :
- Bien que les fruits et légumes apportent du potassium, il n’est pas question de les supprimer car ils sont sources de fibres et de bicarbonates : les bicarbonates vont rééquilibrer la tendance à l’acidose de ces patients et les fibres lutter contre la constipation et favoriser la sécrétion intestinale de potassium, donc son élimination par les fèces. La suppression des fruits et des légumes est donc contre-productive, car elle favorise à la fois la constipation et donc la réabsorption du potassium, et l’acidose.
- Les aliments à limiter, car pourvoyeurs de potassium, sont essentiellement la charcuterie, les viandes transformées qui apportent aussi beaucoup d’acide et vont donc favoriser la rétention de potassium. Il faut par conséquent recommander une restriction protéique et, surtout, limiter les charcuteries pauvres en sodium, qui sont « salées » avec du potassium.
- Il convient également de limiter la consommation de chocolat, qui favorise la constipation, ainsi que les fruits secs (noix de cajou, cacahuètes, abricots, figues, dattes séchées…) qui apportent beaucoup de potassium.
- Enfin, il faut recommander à ces patients d’éviter la consommation de soupes du commerce et de compléments alimentaires qui apportent beaucoup de potassium et proscrire les sels de régime qui sont des sels de potassium.
Ces conseils diététiques sont tellement importants que le législateur a prévu le financement d’une consultation diététique au moins une fois par an chez tous les patients MRC de stade 4/5 (DFGe inférieur à 30).
En résumé, il faut manger le plus « naturel » et le moins transformé possible.
Facteurs surajoutés déclenchant ou aggravant l’hyperkaliémie
La première étape du traitement consiste à débuter ou augmenter la posologie du furosémide si le patient est en surcharge hydrosodée (patient un peu congestif avec œdèmes), ce qui va lui permettre d’uriner plus de potassium, mais aussi améliorer le contrôle de la pression artérielle, de l’albuminurie et diminuer une éventuelle dyspnée d’effort.
La deuxième étape consiste à rechercher une acidose en dosant le taux de bicarbonate plasmatique : s’il est inférieur à 23 mmol/L, il faut supplémenter en bicarbonate de sodium, avec une préparation commerciale sous forme de comprimés à 1 g. La correction de l’acidose va entraîner une entrée de potassium dans les cellules et donc abaisser la kaliémie. Par ailleurs, contrôler l’acidose de ces patients est très important, car elle est source de dégradation du cœur, des vaisseaux, des reins, des muscles striés squelettiques et des os.
Si une hyperkaliémie supérieure à 5-5,5 mmol/L persiste, il faut alors prescrire un chélateur de potassium avec une cible de kaliémie entre 4 et 5 mmol/L, pour ne pas risquer d’entraîner une hypokaliémie qui est aussi potentiellement dangereuse. Actuellement, ne sont disponibles en France que deux polystyrènes de calcium et de sodium, qui sont à la fois très désagréables à prendre (goût rebutant) et sources de troubles digestifs. Mais il faut, dans tous les cas, contrôler à tout prix l’hyperkaliémie pour pouvoir maintenir les bloqueurs du SRAA à leurs doses optimales. Médecins comme patients attendent impatiemment la commercialisation de nouveaux chélateurs avec un goût neutre et une parfaite tolérance digestive.
Propos recueillis par le Dr Catherine Bouix auprès du Pr Vincent Esnault,
service de néphrologie-transplantation-dialyse (hôpital Pasteur, Nice).